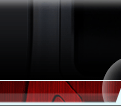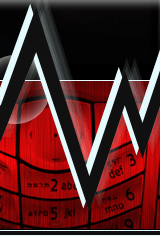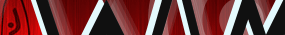L'acteur historique dans les récits de science fiction
Ugo Bellagamba
Ugo Bellagamba
Ou comment la psychologie de l’acteur historique permet une instrumentalisation de l'Histoire dans la science-fiction
 L’Histoire est omniprésente dans la science-fiction. Et sa fonction y est plurielle. Elle intervient soit à titre de source d’inspiration (citons le cycle de Fondation d’Isaac Asimov, largement inspiré de l’Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain d’Occident, d’Edward Gibbon : citons également Tigane de Guy Gavriel Kay et Ariosto Furioso de Chelsea Quinn Yarbro, deux romans dont la trame est directement puisée dans l’histoire de la Renaissance italienne), soit comme contexte (les exemples sont légion : Robert Silverberg met souvent en scène l’Antiquité égyptienne, assyro-babylonienne, grecque et romaine, dans ses romans, Gilgamesh roi d’Ourouk, Thèbes aux Cent Portes, Lettres de l’Atlantide, ainsi que dans nombre de ses nouvelles ; la tétralogie du Lion de Macédoine de David Gemmel se déroule en pleine époque hellénistique), soit, comme enjeu narratif, dans les récits uchroniques qui, depuis quelques années, semblent être redevenus l’apanage des auteurs de science-fiction (l’énumération des mondes ayant connu une histoire antique, médiévale, moderne ou contemporaine, différente de la notre et l’annuaire des « points de divergence » parfois originaux, mais souvent très classiques, n’étant pas l’objet de cet article, je renvoie le lecteur curieux à l’excellent ouvrage d’Eric B. Henriet, L’histoire revisitée ; enfin, l’histoire est également présente dans la science-fiction sous la forme d’un « jeu » sur les grandes figures du genre lui-même, forgées au cours du long 19ème siècle français et européen. Le steampunk, hommage appuyé aux « maîtres » et à leurs créatures, met en scène, dans des décors volontiers victoriens, Conan Doyle et Sherlock Holmes, Jack London et Peter Pan, les martiens et la cavorite de Wells et Némo et le Nautilus de Verne, et prouve que l’identité de la science-fiction s’appuie sur une histoire, des mythes et des valeurs propres.
L’Histoire est omniprésente dans la science-fiction. Et sa fonction y est plurielle. Elle intervient soit à titre de source d’inspiration (citons le cycle de Fondation d’Isaac Asimov, largement inspiré de l’Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain d’Occident, d’Edward Gibbon : citons également Tigane de Guy Gavriel Kay et Ariosto Furioso de Chelsea Quinn Yarbro, deux romans dont la trame est directement puisée dans l’histoire de la Renaissance italienne), soit comme contexte (les exemples sont légion : Robert Silverberg met souvent en scène l’Antiquité égyptienne, assyro-babylonienne, grecque et romaine, dans ses romans, Gilgamesh roi d’Ourouk, Thèbes aux Cent Portes, Lettres de l’Atlantide, ainsi que dans nombre de ses nouvelles ; la tétralogie du Lion de Macédoine de David Gemmel se déroule en pleine époque hellénistique), soit, comme enjeu narratif, dans les récits uchroniques qui, depuis quelques années, semblent être redevenus l’apanage des auteurs de science-fiction (l’énumération des mondes ayant connu une histoire antique, médiévale, moderne ou contemporaine, différente de la notre et l’annuaire des « points de divergence » parfois originaux, mais souvent très classiques, n’étant pas l’objet de cet article, je renvoie le lecteur curieux à l’excellent ouvrage d’Eric B. Henriet, L’histoire revisitée ; enfin, l’histoire est également présente dans la science-fiction sous la forme d’un « jeu » sur les grandes figures du genre lui-même, forgées au cours du long 19ème siècle français et européen. Le steampunk, hommage appuyé aux « maîtres » et à leurs créatures, met en scène, dans des décors volontiers victoriens, Conan Doyle et Sherlock Holmes, Jack London et Peter Pan, les martiens et la cavorite de Wells et Némo et le Nautilus de Verne, et prouve que l’identité de la science-fiction s’appuie sur une histoire, des mythes et des valeurs propres.
L’Histoire et « les histoires » sont un élément incontournable de la science-fiction. D’ailleurs, quel créateur d’univers n’a pas éprouvé le besoin d’enraciner son monde dans une histoire à part entière ? Les plus grands chef-d’œuvres de la science-fiction, de Dune à Hypérion, ne doivent-ils pas toute leur force évocatrice au sens épique de l’Histoire qui les sous-tend ? Toutes ces histoires du futur, depuis le cycle magistral de Robert A. Heinlein jusqu’aux Seigneurs de l’Instrumentalité de Cordwainer Smith, en passant par des œuvres plus confidentielles comme Les premiers et les derniers d’Olaf Stapledon, trahissent la place centrale de l’Histoire dans la construction d’un univers imaginaire cohérent. De là à affirmer que tous les écrivains de science-fiction sont les historiens des futuribles, il n’y a qu’un pas, que l’on ne peut franchir sans se tromper lourdement.
Car il existe une différence majeure, écrasante, entre l’historien et l’auteur de SF. Si l’un comme l’autre se servent des faits historiques, le premier cherche à en tirer des connaissances objectives, alors que le second les asservit à une fiction. L’auteur de SF ne sera jamais un historien, parce que s’il le devenait, il serait mauvais, illisible et impubliable. Il creuse le sillon à l’endroit du champ que redoute le plus le chercheur : celui de la libre extrapolation. Il est un raconteur d’histoires avant tout. Et parce qu’il se doit de « conter », l’auteur de SF n’utilise jamais l’Histoire pour elle-même, mais il s’en sert comme source d’inspiration, décor, ou, dans les uchronies, enjeu narratif. Cela signifie qu’il « l’instrumentalise » dans son intrigue, les actions et la psychologie de ses personnages. Si l’on a déjà maintes fois parlé de la place de l’Histoire dans la science-fiction, si l’on a étudié plus qu’à l’envi, le voyage dans le temps, l’uchronie et le steampunk, il me semble que l’étude de la psychologie de l’acteur historique dans le récit de fiction, reste un terrain peu exploré à ce jour et qui mérite d’être défriché. Posons-nous la question suivante : comment l’auteur de science-fiction parvient-il à instrumentaliser l’Histoire à travers la psychologie de ses personnages au moment où ceux-ci se trouvent confrontés à un choix crucial, à la nécessité d’un acte qui, dans le récit, est « historique » ?

Il s’agit ici d’étudier l’articulation entre l’histoire « personnelle » du personnage qui « incarne » l’acteur historique dans le récit et l’Histoire du Monde elle-même. L’une et l’autre se déterminent réciproquement, au rythme de l’action. Que l’Histoire du Monde soit purement imaginaire ou simplement divergente, que cet univers soit uchronique ou pas, ne modifie pas, fondamentalement, la psychologie de l’acteur historique. Par définition, l’acteur historique (du moins le personnage qui l’incarne) se situe au cœur même des enjeux politiques, sociologiques, et culturels de l’univers du récit. Il est littéralement « englué » dans le présent de l’action et n’obéit qu’à la volonté de défendre un idéal, ou ne répond qu’à la prégnance de la nécessité. En toute logique, quelles que soient ses motivations profondes, il ne peut pas, à l’inverse du lecteur, évaluer « en temps réel » la portée historique de ses actes. Il peut l’envisager avant d’agir, il peut l'estimer après avoir agi, mais jamais prendre du recul pendant l’action.
Ce qui nous donne un premier élément d’analyse : l’acteur historique au moment d’agir se détermine bien plus par sa psychologie que par ses orientations politiques ou ses choix philosophiques. Le présent l’écrase littéralement, quel que soit d’ailleurs le temps du récit, le ramenant à la situation de n’importe quel individu qui subit la pression des événements. Ainsi, que l’on ait une conception marxiste ou volontariste de l’Histoire (tout en sachant que la première oblitère naturellement la plupart des hypothèses d’uchronie, mais il s’agit d’un autre débat que nous ne mènerons pas ici), force est de reconnaître que l’acteur historique, au moment même où il agit, ou n’agit pas, n’est jamais le héros parfait ou le traître accompli que l’Histoire fait de lui par la suite. Qu’il se décide à mettre en scène une révolution, une guerre, un coup d’Etat, une crise politique quelle qu’elle soit, un auteur doit donc garder présent à l’esprit, que son acteur historique est avant tout un personnage vivant. D’où l’inanité de faire de lui un archétype, révolutionnaire idéal ou conservateur obtus, dont le vécu ne se résume qu’à ses convictions politiques.
 L’un des meilleurs exemples de « l’acteur historique » en situation est sans doute le personnage complexe du Docteur Yueh dans le premier volume du cycle de Dune de Frank Herbert (magistralement interprété par Dean Stockwell dans l’adaptation cinématographique injustement décriée de David Lynch). C’est à cause de sa trahison que le Duc Léto Atreïdes et la cité d’Arrakeen qui lui avait été confiée, tombent aux mains des Harkonnens, car ceux-ci qui ont su fléchir son conditionnement impérial. Mais Yueh n’a rien du traître archétypal, dénué de remords et d’arrières pensées. Il agit dans un but qui lui est propre : se venger du Baron Vladimir Harkonnen et de son mentat, Piter de Vries, qui ont séquestré et torturé sa femme pour faire pression sur lui. Pour cette raison, il dote le Duc Léto d’une dent empoisonnée destinée à tuer le Baron et, surtout, organise l’évasion dans le désert profond du fils du Duc, Paul et de sa mère, Jessica, Dame du Bene Gesserit. Il subtilise également l’anneau sigillaire du Duc afin que Paul puisse se prévaloir de son hérédité. Ainsi, tout en trahissant les Atreïdes, Yueh est, en définitive, à l’origine de l’accomplissement de la prophétie du Bene Gesserit qui va faire de Paul Atreïdes, le Muad’dib des Fremen d’Arrakis et le Kwisatz Haderach qui contrôlera la production de l’Epice et balaiera le vieil ordre politique de l’Empire. En un mot, le personnage de Yueh est la « charnière » de toute l’intrigue de Dune. C’est l’acteur historique, par excellence. Ce qui le détermine n’est ni le conditionnement impérial, ni une conviction politique ou une vénalité coupable, mais tout simplement la douleur psychologique de n’avoir pu sauver sa femme. La volonté de se venger des Harkonnens qui lui ont pris son épouse outrepasse toute autre considération, y compris la fidélité qu’il voue au Duc Léto. Littéralement, Yueh instrumentalise les Atréïdes pour accomplir sa vengeance et finit par provoquer une révolution qu’il n’a jamais souhaitée. Il est probable qu’il sente confusément la dimension historique de ses actes au moment de les accomplir, mais il n’y accorde aucune importance. Le monde peut convulser, si cela lui permet d’être en présence du Baron et de savourer sa vengeance. Par sa complexité et sa fragilité, par la simultanéité de son échec et de sa victoire, le Docteur Yueh est certainement l’un des plus beaux acteurs historiques de toute l’histoire de la science-fiction.
L’un des meilleurs exemples de « l’acteur historique » en situation est sans doute le personnage complexe du Docteur Yueh dans le premier volume du cycle de Dune de Frank Herbert (magistralement interprété par Dean Stockwell dans l’adaptation cinématographique injustement décriée de David Lynch). C’est à cause de sa trahison que le Duc Léto Atreïdes et la cité d’Arrakeen qui lui avait été confiée, tombent aux mains des Harkonnens, car ceux-ci qui ont su fléchir son conditionnement impérial. Mais Yueh n’a rien du traître archétypal, dénué de remords et d’arrières pensées. Il agit dans un but qui lui est propre : se venger du Baron Vladimir Harkonnen et de son mentat, Piter de Vries, qui ont séquestré et torturé sa femme pour faire pression sur lui. Pour cette raison, il dote le Duc Léto d’une dent empoisonnée destinée à tuer le Baron et, surtout, organise l’évasion dans le désert profond du fils du Duc, Paul et de sa mère, Jessica, Dame du Bene Gesserit. Il subtilise également l’anneau sigillaire du Duc afin que Paul puisse se prévaloir de son hérédité. Ainsi, tout en trahissant les Atreïdes, Yueh est, en définitive, à l’origine de l’accomplissement de la prophétie du Bene Gesserit qui va faire de Paul Atreïdes, le Muad’dib des Fremen d’Arrakis et le Kwisatz Haderach qui contrôlera la production de l’Epice et balaiera le vieil ordre politique de l’Empire. En un mot, le personnage de Yueh est la « charnière » de toute l’intrigue de Dune. C’est l’acteur historique, par excellence. Ce qui le détermine n’est ni le conditionnement impérial, ni une conviction politique ou une vénalité coupable, mais tout simplement la douleur psychologique de n’avoir pu sauver sa femme. La volonté de se venger des Harkonnens qui lui ont pris son épouse outrepasse toute autre considération, y compris la fidélité qu’il voue au Duc Léto. Littéralement, Yueh instrumentalise les Atréïdes pour accomplir sa vengeance et finit par provoquer une révolution qu’il n’a jamais souhaitée. Il est probable qu’il sente confusément la dimension historique de ses actes au moment de les accomplir, mais il n’y accorde aucune importance. Le monde peut convulser, si cela lui permet d’être en présence du Baron et de savourer sa vengeance. Par sa complexité et sa fragilité, par la simultanéité de son échec et de sa victoire, le Docteur Yueh est certainement l’un des plus beaux acteurs historiques de toute l’histoire de la science-fiction.Il s’ensuit une deuxième considération : si la psychologie de l’acteur historique est déterminante dans l’instrumentalisation de l’Histoire dans le récit de fiction, il faut que l’auteur choisisse la meilleure façon de mettre en lumière cette psychologie. Car, c’est en elle que réside toute la saveur du « moment historique » qui porte le récit de SF. Et la technique narrative la plus évidente de toutes, celle qui, de surcroît, paraît la plus facile, la plus naturelle, est l’utilisation du point de vue subjectif que de trop nombreux auteurs de SF rechignent à adopter. En adoptant, dans l’écriture du récit, le point de vue subjectif de l’acteur historique, plutôt qu’un point de vue omniscient qui dévoile au lecteur, pêle-mêle, les informations-clefs et les émotions primordiales de tous les personnages, on plonge littéralement dans le « for intérieur » de l’acteur historique. Lorsque j’emploie le terme de « for intérieur », je le fais à la fois dans son sens généraliste (ses pensées, ce que le personnage croit, ce qui le pousse à agir) et au sens juridique du terme, « for » signifiant tribunal. Et, avec ce second sens, on touche au bénéfice le plus intéressant du point de vue subjectif. Car, l’acteur historique étant un personnage vivant, lorsqu’il se trouve confronté à la situation extrême qui va faire de lui un « acteur historique », il est toujours en procès avec lui-même. Son « for » intérieur est le théâtre d’une lutte entre ses engagements politiques et ses traits psychologiques, entre ce qu’il doit faire au nom de ses convictions et ce qu’il juge juste de faire au nom de ses émotions. Aucune autre forme de narration ne parvient à rendre aussi sensibles au lecteur les tiraillements de l’acteur historique au moment où il agit. Percevoir ses doutes, c’est lui conférer une humanité sans laquelle il n’est qu’un élément du récit parmi d’autres. C’est précisément ce que j’ai essayé de faire dans ma novella uchronique, L’Apopis Républicain.

En l’espèce, le personnage de Trismégista, franc-maçon révolutionnaire, infiltré dans une expédition scientifique à destination de Titan, est chargé d’assassiner l’Aiglon, le Prince héritier d’un Empire napoléonien qui ne s’est jamais effondré, dans l’histoire divergente qui sert de trame au récit. Le combat pour la République, la volonté de faire triompher les valeurs d’égalité, de liberté et de laïcité, bafouées par l’Empire, légitiment pleinement l’assassinat politique qu’il s’apprête à commettre. Mais, d’un autre côté, la rencontre avec l’Aiglon pendant la durée de l’expédition, le fait de découvrir qu’il s’agit d’un être jeune et sensible qui n’a rien de commun avec la figure du tyran sanguinaire qu’il s’était forgée, le fait de partager avec lui l’amour de la connaissance et l’émotion d’une découverte archéologique extraordinaire, font de l’acte que Trismégista s’apprête à commettre, un crime à part entière. Dès lors, il commence à hésiter et prend toute sa dimension d’acteur historique, partagé entre la justesse de son combat et l’horreur de l’acte qui la sous-tend. En adoptant un point de vue subjectif, en ouvrant le « for interne » de Trismégista au lecteur, j’ai essayé de placer l’acteur historique au cœur de mon récit et d’en faire, peut-être, le principal intérêt.

Les exemples d’acteur historique traité en point de vue subjectif, ce qui inclut évidemment le récit à la première personne et n’exclut pas l’existence d’autres points de vue parallèles, sont pourtant relativement peu nombreux dans la science-fiction. On peut citer le personnage d’Helward Mann dans Le Monde Inverti de Christopher Priest, celui du flic Andy Rush dans Soleil Vert de Harry Harrison, et celui de James Andrek dans L’Anneau de Ritornel de Charles Harness. Tous trois se confrontent aux règles aberrantes de leur univers et le remettent en cause. Mais l’une des difficultés à trouver de tels exemples découle du fait que, souvent, l’acteur historique n’est pas le personnage principal du récit, comme l’illustre l’exemple du Docteur Yueh, que j’ai déjà évoqué.
 Il y a, en dernière limite, un troisième élément à prendre en considération : c’est le lien qui existe entre l’existence d’un acteur historique et la dimension utopique (ou dystopique) du récit. Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, le fait qu’il s’agisse d’une uchronie est indifférent en ce qui concerne l’existence d’un acteur historique. La plupart du temps, les personnages des récits uchroniques ne sont pas les « déclencheurs » de la divergence historique, mais bien plutôt les « révélateurs » de celle-ci. C’est en suivant la manière dont ils explorent leur univers, que le lecteur lève peu à peu le voile sur le fameux « point de divergence » qui constitue le levier du texte. En ce sens, l’acteur historique dans les uchronies n’est pas très différent de l’acteur historique dans les autres récits de SF. Certaines uchronies ne mettent en scène aucun acteur historique au sens strict du terme. L’excellent recueil de Robert Silverberg, Le Nez de Cléopatre, en est une illustration.
Il y a, en dernière limite, un troisième élément à prendre en considération : c’est le lien qui existe entre l’existence d’un acteur historique et la dimension utopique (ou dystopique) du récit. Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, le fait qu’il s’agisse d’une uchronie est indifférent en ce qui concerne l’existence d’un acteur historique. La plupart du temps, les personnages des récits uchroniques ne sont pas les « déclencheurs » de la divergence historique, mais bien plutôt les « révélateurs » de celle-ci. C’est en suivant la manière dont ils explorent leur univers, que le lecteur lève peu à peu le voile sur le fameux « point de divergence » qui constitue le levier du texte. En ce sens, l’acteur historique dans les uchronies n’est pas très différent de l’acteur historique dans les autres récits de SF. Certaines uchronies ne mettent en scène aucun acteur historique au sens strict du terme. L’excellent recueil de Robert Silverberg, Le Nez de Cléopatre, en est une illustration.C’est dans les récits à dimension utopique ou contre-utopique que l’acteur historique, en revanche, prend tout son sens narratif. Car tout auteur de Science-fiction qui entreprend d’écrire une utopie ou une contre-utopie, même s’il se réclame d’un courant littéraire et politique remontant à Platon, le fait avec les codes narratifs de son temps, c’est-à-dire d’une manière très différente de celle de ses prédécesseurs. Or, on l’a dit, les auteurs de science-fiction sont avant tout des « raconteurs d’histoire », dont les œuvres se concentrent sur les actes et les épreuves affrontées par leurs personnages dans un contexte imaginaire donné. Ils ne peuvent, en conséquence, décrire des utopies figées dans leur perfection, des mondes statiques, voire statufiés, comme l’ont fait précédemment Thomas More ou Tommaso Campanella. A de très rares exceptions près, les auteurs de science-fiction décrivent des utopies qui se fondent ou des contre-utopies qui s’effondrent. Ce qui les intéresse le plus, en terme de force évocatrice, c’est le passage de l’immobilité au mouvement, de l’ordre au désordre, de l’harmonie au chaos, ou vice-versa. Ce qui donne le « beau rôle », invariablement, à notre acteur historique. Car plus l’univers de l’auteur est utopique (ou contre-utopique, les deux termes s’équivalant dans la description d’une société figée) plus il implique l’intervention, dans le récit, d’un « rouage qui grippe », d’un personnage qui, prenant conscience des faux-semblants de l’univers ou de l’horreur de la Machine du Monde, cherche à s’en affranchir en compromettant son bon fonctionnement. Aller à l’encontre de l’ordre établi, après l’avoir fidèlement servi, briser la barrière des certitudes, après avoir été dogmatique. C’est précisément la quintessence de l’acteur historique, tout à la fois corrupteur de l’ordre et libérateur de l’individu.
Le meilleur de tous les exemples est certainement celui du pompier Montag dans Fahrenheit 451, le chef-d’œuvre de Ray Bradbury. Après avoir brûlé les livres comme symbole honni de la diversité et de la liberté, il bascule lentement dans la rébellion, jusqu’à devenir l’un de ces « hommes-livres » qui réinventent un monde. Il faut citer, également, le magnifique roman de Joëlle Wintrebert, Pollen, qui jongle brillamment sur la dialectique utopique et met en scène un magnifique acteur historique, riche de ses doutes et de ses contradictions.

Toutes ces remarques au sujet de l’acteur historique dans la science-fiction ne sont en rien une réflexion aboutie, mais tout au contraire, l’ouverture d’un débat, le début d’une exploration narrative. Il reste tout à dire sur les mécanismes du personnage qui affronte le monde, parfois à son cœur défendant. Quant à la place de l’Histoire dans la Science-fiction, elle ne peut aller que croissant, tant il est avéré que le genre puise aux sources de la connaissance historique et scientifique. En guise de conclusion, on pourrait dire que l’engouement actuel pour l’uchronie, la prolifération du steampunk et l’omniprésence de l’Histoire dans les ouvrages les plus récents, sont peut-être le signe de l’émergence d’un nouveau courant, cousin de la déjà vieille « hard-science » si chère aux auteurs américains. Une manière de « hard-history » qui orchestrerait la réappropriation du roman historique par le champ science-fictif, comme l’illustrent des œuvres récentes telles que La folie de Dieu de Juan Miguel Aguileira, ou encore, Le Roi d’août de Michel Pagel. On ne peut que se réjouir que la transversalité actuelle de l’Imaginaire manifeste une inclinaison aussi nette pour l’Histoire.